En 1961, en avril, paraissait un article de Martin Gardner dans la revue Scientific American (vous en lisez l’édition française !). Le mathématicien, dans sa rubrique « Jeux mathématiques », y rendait compte de l’ouvrage An Introduction to Geometry, du britannique Harold Scott MacDonald Coxeter, alors à l’université de Toronto, au Canada. Le livre explorait les géométries non euclidiennes et, en guise d’illustration, montrait des œuvres d’un artiste néerlandais nommé Maurits Cornelis Escher, plus souvent surnommé « M. C. Escher ». Deux de ces gravures figuraient dans le magazine qui par ailleurs offrit à une troisième, sollicitée pour l’occasion et après colorisation, les honneurs de la couverture !
Dans les trois cas, il s’agit de pavages du plan par des motifs s’imbriquant les uns dans les autres de façon à ne laisser aucun vide, à la manière des pièces d’un puzzle : à la une de Scientific American, ces motifs sont des oies volant pour moitié vers la gauche, les autres vers la droite.
Quelque cinq ans plus tard, Gardner consacra l’entièreté d’une de ses chroniques à celui qui allait devenir le « chouchou » des mathématiciens. Et de fait, Escher écrivit à son ami Cornelius Roosevelt (agent de la CIA et petit-fils de l’ancien président Theodore Roosevelt) : « Après l’article de Monsieur Gardner, mes clients, en particulier aux États-Unis, ne me laissent plus aucun répit. » Par exemple, Stanley Kubrick lui proposa de représenter une scène pour la fin de 2001, l’Odyssée de l’espace, tandis que Mick Jagger souhaitait utiliser l’une de ses œuvres pour la couverture d’un album des Rolling Stones.
De cette époque date un engouement jamais démenti pour les compositions de l’artiste où le cerveau s’évertue à comprendre des constructions impossibles, des explorations de l’infini, des pavages complexes… Une rétrospective d’envergure, présentée à la Monnaie de Paris, permet d’explorer ces liens intimes entre art et science, entre rigueur de la construction et imagination sans bornes. Comment Escher s’est-il aventuré entre ces deux mondes qu’il a réconciliés à sa façon ?
De Grenade à Amsterdam
Une première source d’inspiration importante est, en 1936, une visite de l’Alhambra, à Grenade, en Espagne, où les zelliges, ces mosaïques décoratives typiques de l’architecture mauresque, le marquent profondément. Il s’en ouvre à son demi-frère, Berend Escher, professeur de cristallographie à l’université de Leyde, aux Pays-Bas, qui lui fait découvrir les travaux des pionniers de ce domaine, Evgraf Fedorov et George Pólya. En s’intéressant aux cristaux bidimensionnels, tous deux ont montré qu’il existe dix-sept groupes de symétrie capables de paver le plan. De là, Escher comprend qu’il est possible de déformer les trois seuls polygones réguliers (le carré, le triangle équilatéral et l’hexagone) pouvant remplir le plan sans créer d’espaces vides si l’on respecte les symétries précédentes.
Dès lors, lézards, oiseaux, poissons, cavaliers… pouvaient, emboîtés, envahir le plan de plusieurs œuvres. Les pavés, ou « tesselles », sont parfois identiques, mais pas toujours (ainsi, dans Remplissage du plan I, de 1951, tous les motifs sont différents), et dans certaines compositions, on observe une transformation d’un type vers un autre. Par exemple, dans Air et eau , de 1938, la zone centrale est entièrement comblée par des oiseaux et des poissons, les premiers dominant progressivement le haut et les seconds le bas.

Air et eau I, une gravure sur bois de 1938.
© 2025 The M. C. Escher Company, The Netherlands.Cependant, ces œuvres relèvent encore de la géométrie euclidienne, les pavés gardant approximativement les mêmes dimensions. Les choses changent d’abord à la fin des années 1930 avec des compositions dans lesquelles, par exemple, des lézards (Développement II, 1939) grossissent à mesure qu’ils s’éloignent du centre selon une progression géométrique, puis de façon déterminante en 1954, quand Escher rencontre Coxeter au symposium sur la symétrie qui se tenait à Amsterdam. Ce sera le début d’une longue correspondance entre l’expert et l’autodidacte.
Géodésiques et hypercycles
À l’origine, il y a le désir de l’artiste de représenter l’infini dans un espace clos. Le mathématicien y répondra avec son article Crystal Symmetry and Its Generalizations, qu’il a présenté lors du congrès de mathématiciens (et publié en 1957). Y figure un disque de Poincaré, c’est-à-dire une représentation conforme (les angles sont conservés, mais pas les distances) du plan hyperbolique (où, contrairement au plan euclidien, par un point extérieur à une droite passent une infinité de parallèles à celle-ci), pavé de triangles. C’est une révélation ! Et Escher d’écrire à l’auteur : « Bien que le texte de votre article soit trop savant pour [moi], certaines illustrations […] m’ont vraiment bouleversé. »

Limite du Cercle III, une gravure sur bois de 1959.
© 2025 The M. C. Escher Company, The Netherlands.Des œuvres parmi les plus connues d’Escher, comme la série des quatre Limites du cercle, dont la IV est peuplée d’anges et de démons, ainsi que sa dernière gravure, Serpents, en 1969, naîtront de cet échange. La troisième version (datée de 1959), composée de poissons, laisse Coxeter tout aussi enthousiaste que perplexe.
En effet, les lignes le long desquelles les poissons, « des flèches enflammées » selon l’artiste, se déplacent ne correspondent pas aux géodésiques hyperboliques, les « droites » du disque de Poincaré, des arcs de cercles qui forment avec le bord un angle de 90 degrés. Ce sont en fait des hypercycles, des courbes constituées des points situés à une distance d (on parle de rayon) d’une droite donnée D (ou axe). Ces courbes, qui ont certaines propriétés analogues à celles des droites euclidiennes, d’autres à celles des cercles euclidiens, forment un angle constant avec le bord. En 1997, Coxeter publiera une étude géométrique de Limites du cercle III, dans laquelle il calcule que cet angle est de 80 degrés.
Le triangle et l’escalier de Reutersvärd
Un autre mathématicien a joué un grand rôle dans l’œuvre d’Escher en lui ouvrant la porte vers des mondes chimériques. Il s’agit du Britannique Roger Penrose, prix Nobel de physique en 2020 pour ses travaux sur les trous noirs, et à qui l’on doit l’idée de pavages non périodiques, ainsi que quelques figures dites « impossibles » dont s’est emparé l’artiste. Elles consistent en la représentation, en deux dimensions, d’un objet qui ne peut pas matériellement exister en trois dimensions.
Leur inventeur est le Suédois Oscar Reutersvärd qui, en 1934 (il a alors 19 ans) imagine un triangle composé de côtés semblant former deux à deux des angles droits, ce qui est impossible en géométrie euclidienne. Au prix d’une illusion d’optique rapprochant deux extrémités spatialement éloignées, il est possible de le construire – plusieurs sculptures l’attestent – uniquement lorsqu’elles sont vues selon un angle précis. Ce triangle a été « réinventé » par Roger Penrose et son père Lionel (qui lui ont donné injustement leur nom), psychiatre et généticien, dans un article du British Journal of Psychology, publié en 1958, et consacré… aux objets impossibles.
Ce triangle de Penrose est à la base de Cascade, une lithographie de 1961 où de l’eau dévale, à partir d’une roue à aubes, des segments de canaux reliés par trois angles droits, avant de se retrouver au-dessus de son point de départ. C’est impossible dans les trois dimensions de l’espace euclidien, bien sûr, mais sur une feuille, par un habile jeu de perspective, c’est un mouvement perpétuel qui est rendu plausible !

Cascade, une lithographie de 1961.
© 2025 The M. C. Escher Company, The Netherlands.Autre figure impossible inventée par Oscar Reutersvärd et mise en avant par les Penrose dans leur article, l’escalier encore malnommé de Penrose dérive du triangle précédent. Ici, une série de marches, après quatre angles droits, revient à son point de départ, créant l’illusion d’un escalier sans fin. Chez Escher, dans Monter et descendre, cette structure paradoxale se retrouve au sommet d’un monastère et est parcourue, dans les deux sens, de religieux dans une quête éternelle.
Une dernière figure a occupé une place importante dans l’œuvre d’Escher, mais elle n’a rien d’impossible, quand bien même elle en a l’air. Il s’agit du ruban de Möbius, du nom du mathématicien August Ferdinand Möbius : cette surface, dite « compacte », n’est dotée que d’une seule face, et un seul bord, contrairement à un ruban classique qui en possède deux. Dans la gravure Ruban de Möbius II, de 1963 , cette surface est sillonnée par quelques fourmis.

Ruban de Möbius II, une gravure sur bois de 1963.
© 2025 The M. C. Escher Company, The Netherlands.Ces quelques œuvres, parmi les très nombreuses présentées dans l’exposition qu’accompagnent plusieurs contenus pédagogiques, vidéos et installations interactives, révèlent que M. C. Escher est toujours resté à la frontière entre les deux mondes, des mathématiques et de l’art. Il l’écrit à son fils et à sa femme en 1959 : « En fin de compte, je n’appartiens plus à aucun domaine. Les mathématiciens peuvent bien me sourire avec bienveillance […], mais pour eux, je reste un amateur. Quant aux artistes, ils ne font guère que s’irriter. »
Sa motivation était ailleurs : « Je ne peux m’empêcher de me moquer de toutes nos certitudes inébranlables », déclarait-il en 1965. « Êtes-vous sûr qu’un sol ne peut pas être aussi un plafond ? Êtes-vous absolument certain que vous montez lorsque vous gravissez un escalier ? Pouvez-vous affirmer qu’il est impossible d’avoir le beurre et l’argent du beurre ? » Allez vous en rendre compte par vous-mêmes !

 il y a 2 day
1
il y a 2 day
1


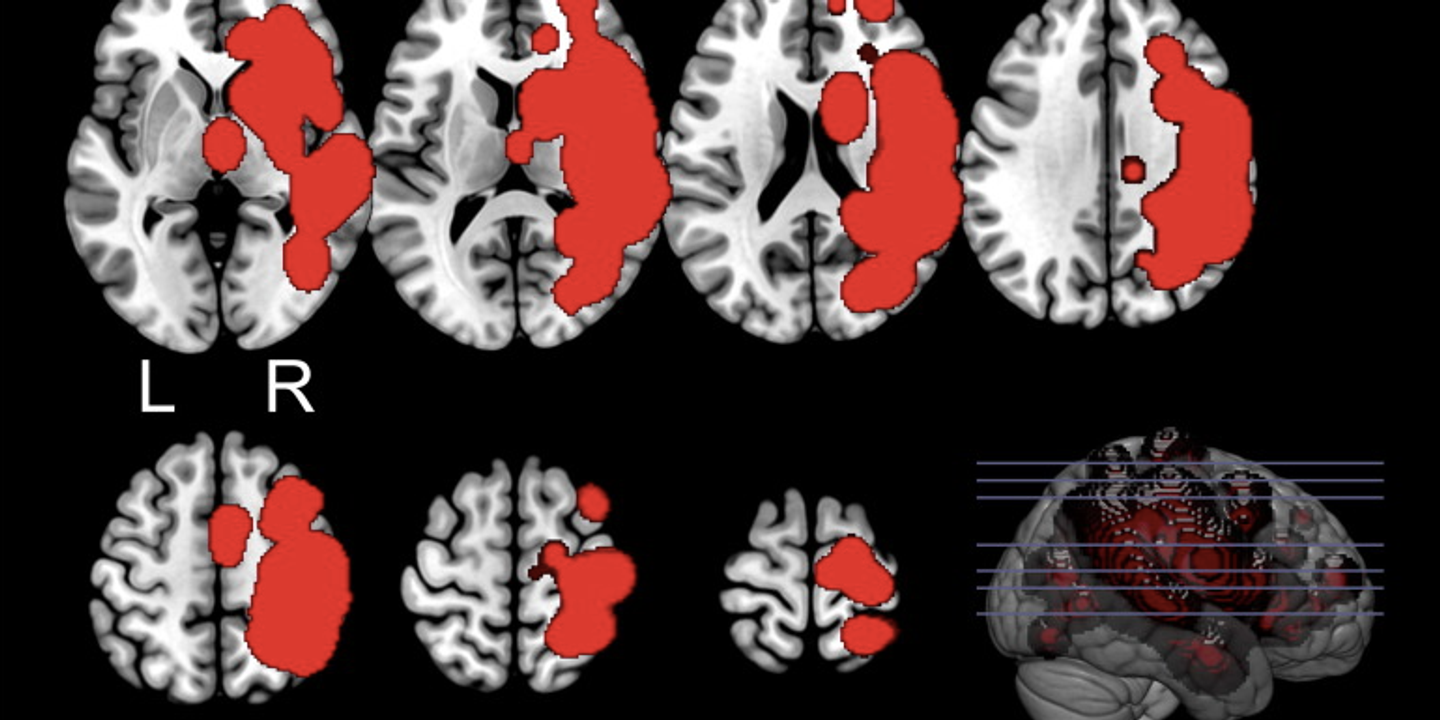








 English (US) ·
English (US) ·